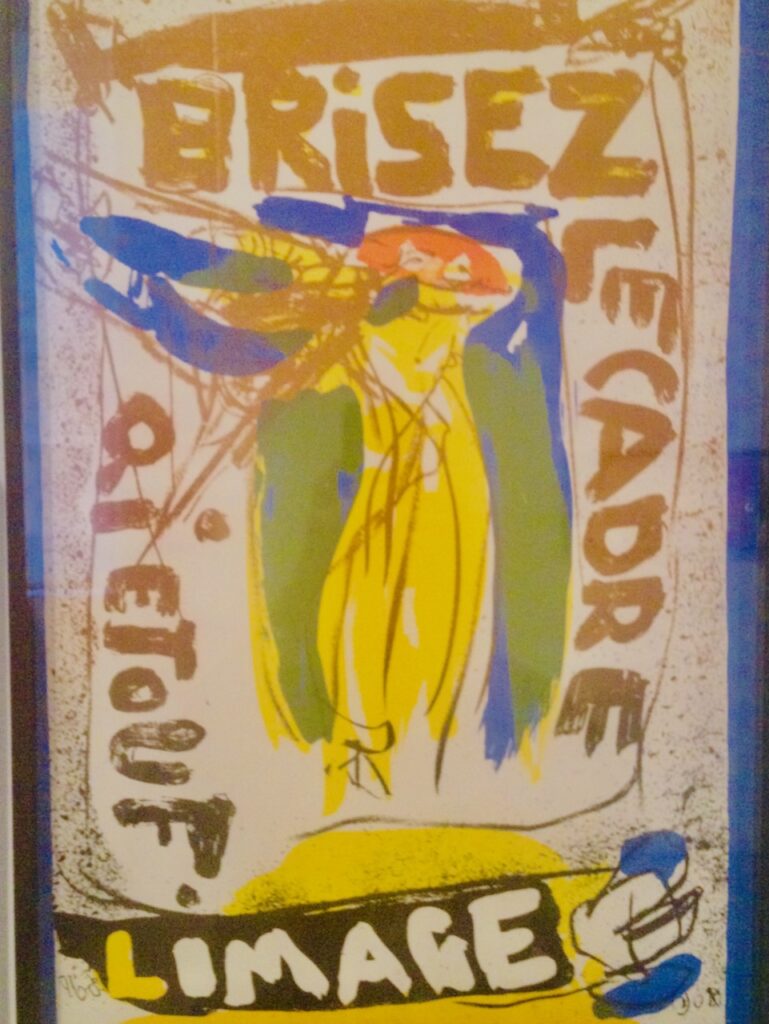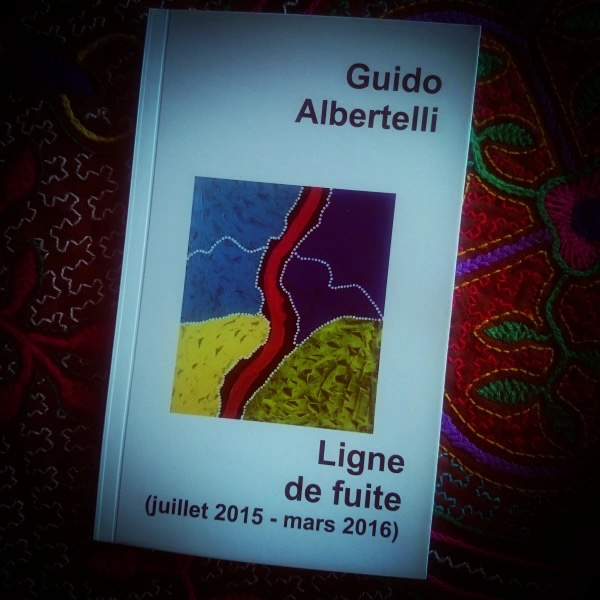Samedi 18 et dimanche 19 octobre 2025, Bois de Finges (VS)
Week-end de découverte de la «marche médecine», une pratique dans la nature, qui n’est pas sans rapports avec l’hypnose (j’avais déjà proposé cela, sur une demi-journée, sous le titre de «pas de transe»)
Présentation ci-dessous. N’hésitez pas à me contacter pour plus d’infos!
Le monde naturel est là, juste là, ouvert, offert : les arbres, le ciel, les rochers, l’herbe, la terre, le ruisseau, les nuages, les oiseaux, les traces du chevreuil…. Comme un appel à y aventurer quelques pas. Et si c’était une invitation à aller s’y perdre pour mieux s’y retrouver ?
Il est si facile, aujourd’hui, de se sentir désorienté, égaré, dans le monde «domestiqué», ou dans le désordre de nos pensées. De se sentir agité, confus, morcelé, ou alors figé, embourbé.
La pratique de la «marche médecine», que nous vous proposons de venir découvrir le temps d’un week-end dans la nature, est une manière extraordinairement simple, mais aussi profonde et puissante, de retrouver le cap, de se mettre à l’écoute d’une sagesse plus grande que nous-mêmes, de retrouver du soutien, de faire sens de ce qui nous arrive, nous bouscule, d’y voir plus clair.
C’est dans cet esprit que nous vous invitons à prendre un temps pour toi, en nature : poser une intention, explorer en se laissant errer dehors, seul.e. Écouter ce que le vivant reflète. Revenir avec une histoire, la partager en cercle et en recevoir les enseignements.
Parce que être dehors, marcher sur la terre, sentir le vent sur le visage, peut-être se faire mouiller par la pluie, entendre le cri de la buse ou du corbeau… C’est la façon la plus simple et la plus directe de s’éprouver vivant. Animal. Et c’est ça qui réoriente. Redonne de l’élan. Libère la vie, joyeuse et puissante, que nous portons en nous – et qui nous porte.
Concrètement, vous recevrez une introduction à «la roue de médecine de la nature humaine», une représentation, basée sur la nature et ses cycles, des différentes directions qui nous constituent – comme une boussole pour pouvoir s’orienter. Vous passerez plusieurs heures dans la nature, seul.e. Vous raconterez les histoires de vos marches dans le cercle des participants, et vous écouterez celles des autres. Vous préparerez, avant de repartir, votre retour: comment intégrer dans sa vie les enseignements, ressources, changements dont vous aurez fait l’expérience. Vous serez accompagné.e tout au long par deux guides expérimentés, aussi bien pour préparer votre temps dehors que pour faire briller la force et la sagesse enveloppées dans l’histoire que vous raconterez au retour.
Lieu et dates
Bois de Finges, Sierre, samedi 18 octobre à 8h45 au dimanche 19 octobre à 17h00
Prix
300.- CHF pour le week-end, hébergement, repas samedi soir et brunch dimanche compris
Des arrhes de 150.- CHF, non remboursables, sont à verser pour valider l’inscription. Le solde du stage est à payer au plus tard au début du week-end (merci d’amener le solde exact si c’est en cash). Les arrhes sont à verser sur le compte de l’Association pour les Rites de Passage, IBAN CH16 0839 0039 1577 1000 1, Banque Alternative Suisse, Association RoP, Rue du Port-Franc 11, cp 161, 1001 Lausanne.
Matériel :
Un pic-nic pour le samedi midi, des chaussures des vêtements adaptés à la météo et à la marche en forêt, un coussin ou couverture ou chaise de camping basse, pour s’asseoir sur le sol.
Une liste complète sera envoyée aux participant.e.s quelques jours avant, avec également le lieu de rendez-vous.
Les guides
– Guido : hypnothérapeute, créateur et responsable de «la matu en liberté» (accompagnement pour étudiants auto-didactes), ancien maître de philosophie au gymnase, formé en 2024 comme guide de rite de passage selon la tradition de The School of Lost Borders.
– Mélina : Travailleuse sociale de formation et actuellement accompagnante en réhabilitation, Mélina s’est formée en 2024 comme guide de rite de passage selon la tradition de The School of Lost Borders
Informations et inscriptions:
Mélina: 078 893 72 70, melina_gasser@hotmail.ch
Guido: 079 326 32 59, contact@guidoalb.ch